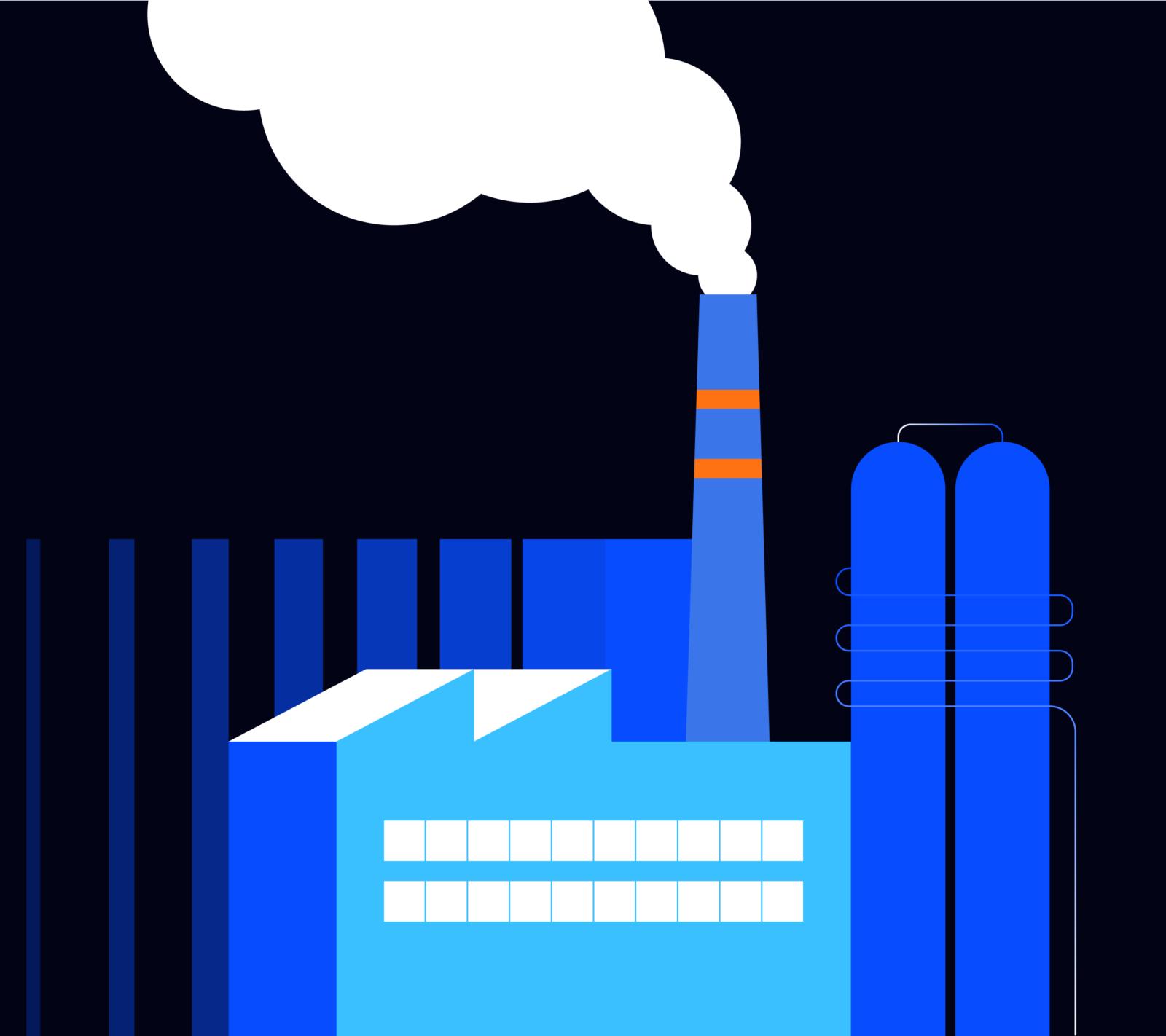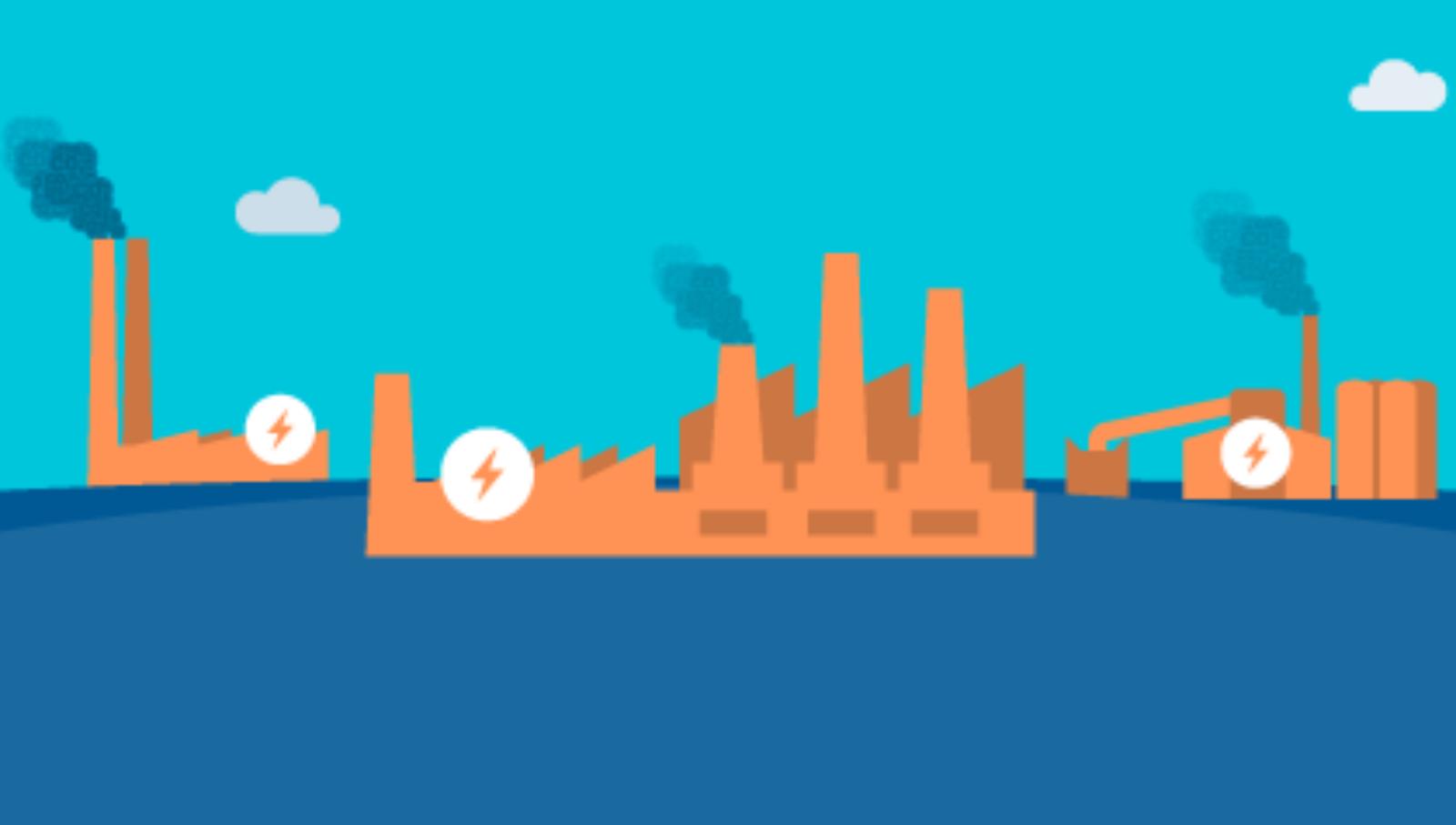Industrie
Le secteur de l’industrie fait doublement face à la contrainte climat-énergie : non seulement il doit planifier sa sortie des énergies fossiles et réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre, mais il doit également produire ce qui permettra au reste de la société d'en faire de même.